Chargement de la carte...
{"format":"leaflet","minzoom":false,"maxzoom":false,"limit":2000,"offset":0,"link":"all","sort":[""],"order":[],"headers":"show","mainlabel":"","intro":"","outro":"","searchlabel":"... further results","default":"","import-annotation":false,"width":"300px","height":"350px","centre":{"text":"","title":"","link":"","lat":48.585458,"lon":7.741725,"icon":""},"title":"","label":"","icon":"/assets/oval-15.png","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":17,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":true,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","showtitle":true,"hidenamespace":true,"template":"","userparam":"","activeicon":"/assets/pin.png","pagelabel":false,"ajaxcoordproperty":"Coordonn\u00e9es","ajaxquery":"%5B%5BAdresse%3A%2B%5D%5D","locations":[{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:1_Quai_Kellermann_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:1 Quai Kellermann (Strasbourg)\"\u003E1 Quai Kellermann (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"1 Quai Kellermann (Strasbourg)","link":"","lat":48.58538,"lon":7.74412,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:1_Quai_de_Paris_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:1 Quai de Paris (Strasbourg)\"\u003E1 Quai de Paris (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"1 Quai de Paris (Strasbourg)","link":"","lat":48.58417,"lon":7.74139,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:1_place_Cl%C3%A9ment_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:1 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)\"\u003E1 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"1 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)","link":"","lat":48.587179080827,"lon":7.7429580688477,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:1_place_Cl%C3%A9ment_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:1 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)\"\u003E1 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"1 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)","link":"","lat":48.5871017,"lon":7.7430742,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:1_rue_Kuhn_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:1 rue Kuhn (Strasbourg)\"\u003E1 rue Kuhn (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"1 rue Kuhn (Strasbourg)","link":"","lat":48.584986088907,"lon":7.7403348684311,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:1_rue_du_Noyer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:1 rue du Noyer (Strasbourg)\"\u003E1 rue du Noyer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"1 rue du Noyer (Strasbourg)","link":"","lat":48.585393915983,"lon":7.7438727021217,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:10_Quai_Kl%C3%A9ber_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:10 Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)\"\u003E10 Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"10 Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)","link":"","lat":48.586318573497,"lon":7.744283080101,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:10_Quai_de_Paris_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:10 Quai de Paris (Strasbourg)\"\u003E10 Quai de Paris (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"10 Quai de Paris (Strasbourg)","link":"","lat":48.5851712,"lon":7.7434424,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:10_quai_Saint_Jean_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:10 quai Saint Jean (Strasbourg)\"\u003E10 quai Saint Jean (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"10 quai Saint Jean (Strasbourg)","link":"","lat":48.58395,"lon":7.73928,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:10_rue_Kuhn_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:10 rue Kuhn (Strasbourg)\"\u003E10 rue Kuhn (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"10 rue Kuhn (Strasbourg)","link":"","lat":48.585092547023,"lon":7.7395731210709,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:10a_rue_de_S%C3%A9bastopol_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:10a rue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)\"\u003E10a rue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"10a rue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)","link":"","lat":48.5865869,"lon":7.743097,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:11_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:11 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E11 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"11 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.583755,"lon":7.740762,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:12_quai_Desaix_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:12 quai Desaix (Strasbourg)\"\u003E12 quai Desaix (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"12 quai Desaix (Strasbourg)","link":"","lat":48.583836326964,"lon":7.7406299114227,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:12_quai_Saint_Jean_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:12 quai Saint Jean (Strasbourg)\"\u003E12 quai Saint Jean (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"12 quai Saint Jean (Strasbourg)","link":"","lat":48.58402,"lon":7.73942,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:12_rue_Kuhn_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:12 rue Kuhn (Strasbourg)\"\u003E12 rue Kuhn (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"12 rue Kuhn (Strasbourg)","link":"","lat":48.585087224122,"lon":7.739422917366,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:12_rue_de_S%C3%A9bastopol_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:12 rue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)\"\u003E12 rue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"12 rue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)","link":"","lat":48.5866838,"lon":7.7430239,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:12,_rue_du_Vieux-March%C3%A9-aux-Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:12, rue du Vieux-March\u00e9-aux-Vins (Strasbourg)\"\u003E12, rue du Vieux-March\u00e9-aux-Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"12, rue du Vieux-March\u00e9-aux-Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.5836727,"lon":7.741183,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:13_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:13 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E13 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"13 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.58516,"lon":7.74015,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:13_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:13 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E13 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"13 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.583816715741,"lon":7.7409183576722,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:13_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:13 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E13 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"13 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.583954,"lon":7.7407843999999,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:14_quai_Saint_Jean_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:14 quai Saint Jean (Strasbourg)\"\u003E14 quai Saint Jean (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"14 quai Saint Jean (Strasbourg)","link":"","lat":48.584322494928,"lon":7.7393424510956,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:15_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:15 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E15 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"15 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.583898573211,"lon":7.7409583312134,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:16_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:16 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E16 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"16 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.5837047,"lon":7.7412434,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:18_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:18 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E18 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"18 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.5837525,"lon":7.7414477,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:19_rue_du_Marais_Vert_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:19 rue du Marais Vert (Strasbourg)\"\u003E19 rue du Marais Vert (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"19 rue du Marais Vert (Strasbourg)","link":"","lat":48.586348267323,"lon":7.7404397674591,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2_Petite_rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2 Petite rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E2 Petite rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2 Petite rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.58399246901,"lon":7.7410751581192,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2_Quai_Kellermann_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2 Quai Kellermann (Strasbourg)\"\u003E2 Quai Kellermann (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2 Quai Kellermann (Strasbourg)","link":"","lat":48.585521925815,"lon":7.7444279193878,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2_Quai_de_Paris_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2 Quai de Paris (Strasbourg)\"\u003E2 Quai de Paris (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2 Quai de Paris (Strasbourg)","link":"","lat":48.584306525981,"lon":7.7416303753853,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E2 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.584947054208,"lon":7.7413702011108,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E2 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.585117387217,"lon":7.7413702011108,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E2 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.58478142595,"lon":7.7409837613769,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2_place_Cl%C3%A9ment_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)\"\u003E2 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)","link":"","lat":48.58712711544,"lon":7.743274238623,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2_rue_des_Bonnes_Gens_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2 rue des Bonnes Gens (Strasbourg)\"\u003E2 rue des Bonnes Gens (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2 rue des Bonnes Gens (Strasbourg)","link":"","lat":48.587179080827,"lon":7.7429580688477,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2_rue_des_Bonnes_Gens_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2 rue des Bonnes Gens (Strasbourg)\"\u003E2 rue des Bonnes Gens (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2 rue des Bonnes Gens (Strasbourg)","link":"","lat":48.5871017,"lon":7.7430742,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2_rue_des_Mineurs_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2 rue des Mineurs (Strasbourg)\"\u003E2 rue des Mineurs (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2 rue des Mineurs (Strasbourg)","link":"","lat":48.5872103,"lon":7.7436963,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2_rue_du_Noyer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2 rue du Noyer (Strasbourg)\"\u003E2 rue du Noyer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2 rue du Noyer (Strasbourg)","link":"","lat":48.58493,"lon":7.74377,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:20_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:20 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E20 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"20 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.58382,"lon":7.74203,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:21_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:21 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E21 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"21 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.584076033887,"lon":7.7417653828034,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:24_rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:24 rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E24 rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"24 rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.583893105946,"lon":7.7423706650734,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:25_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:25 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E25 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"25 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.585622417263,"lon":7.7398671269837,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:25_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:25 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E25 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"25 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.58419,"lon":7.74182,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:25_rue_du_Jeu_des_enfants_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:25 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)\"\u003E25 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"25 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)","link":"","lat":48.583673087037,"lon":7.7423143386841,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:26_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:26 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E26 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"26 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.586279862164,"lon":7.7400183677673,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:26_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:26 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E26 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"26 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.5839268,"lon":7.7425548,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:27_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:27 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E27 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"27 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.5858869,"lon":7.7397076,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:27_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:27 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E27 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"27 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.584202,"lon":7.742435,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:28_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:28 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E28 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"28 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.586525109138,"lon":7.7400022745132,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:29_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:29 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E29 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"29 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.586087,"lon":7.739576,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:2bis_Quai_Kl%C3%A9ber_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:2bis Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)\"\u003E2bis Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"2bis Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)","link":"","lat":48.58554321723,"lon":7.7415204048157,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:3_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:3 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E3 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"3 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.5847668,"lon":7.7405273,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:3_rue_du_Noyer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:3 rue du Noyer (Strasbourg)\"\u003E3 rue du Noyer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"3 rue du Noyer (Strasbourg)","link":"","lat":48.58519,"lon":7.74403,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:30_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:30 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E30 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"30 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.58395423175,"lon":7.742645890213,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:32_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:32 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E32 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"32 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.586787882331,"lon":7.7397294171967,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:32_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:32 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E32 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"32 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.583911,"lon":7.742836,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:33_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:33 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E33 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"33 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.584355,"lon":7.743287,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:35_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:35 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E35 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"35 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.586304,"lon":7.739344,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:35_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:35 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E35 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"35 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.5843158,"lon":7.7435202,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:35_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:35 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E35 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"35 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.5843306,"lon":7.743643,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:36_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:36 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E36 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"36 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.586948430815,"lon":7.739417552948,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:36_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:36 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E36 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"36 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.58402,"lon":7.74294,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:37_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:37 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E37 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"37 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.58647,"lon":7.739146,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:39_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:39 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E39 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"39 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.584471538184,"lon":7.7437949180603,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:3bis_rue_du_Noyer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:3bis rue du Noyer (Strasbourg)\"\u003E3bis rue du Noyer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"3bis rue du Noyer (Strasbourg)","link":"","lat":48.585018,"lon":7.744158,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:4_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:4 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E4 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"4 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.58501,"lon":7.740854,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:41_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:41 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E41 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"41 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.584438,"lon":7.743876,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:42_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:42 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E42 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"42 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.587395536034,"lon":7.7391707897186,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:42_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:42 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E42 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"42 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.5862008,"lon":7.7396388,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:44_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:44 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E44 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"44 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.58405,"lon":7.74342,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:45_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:45 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E45 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"45 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.58449,"lon":7.74407,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:46_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:46 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E46 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"46 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.58413,"lon":7.74353,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:46_rue_du_Jeu_des_enfants_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:46 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)\"\u003E46 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"46 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)","link":"","lat":48.5837257,"lon":7.7429992,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:47_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:47 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E47 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"47 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.58445202064,"lon":7.7441811561584,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:5_Quai_de_Paris_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:5 Quai de Paris (Strasbourg)\"\u003E5 Quai de Paris (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"5 Quai de Paris (Strasbourg)","link":"","lat":48.584586,"lon":7.742405,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:5_place_Cl%C3%A9ment_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:5 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)\"\u003E5 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"5 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)","link":"","lat":48.586987416146,"lon":7.7433473472214,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:5_rue_du_Noyer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:5 rue du Noyer (Strasbourg)\"\u003E5 rue du Noyer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"5 rue du Noyer (Strasbourg)","link":"","lat":48.584837,"lon":7.74431,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:54_rue_du_Jeu_des_enfants_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:54 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)\"\u003E54 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"54 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)","link":"","lat":48.583839875652,"lon":7.7435266971588,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:54_rue_du_Jeu_des_enfants_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:54 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)\"\u003E54 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"54 rue du Jeu des enfants (Strasbourg)","link":"","lat":48.583966401924,"lon":7.7435812048935,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:6_Quai_Kl%C3%A9ber_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:6 Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)\"\u003E6 Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"6 Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)","link":"","lat":48.586032917309,"lon":7.743558883667,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:6_Quai_de_Paris_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:6 Quai de Paris (Strasbourg)\"\u003E6 Quai de Paris (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"6 Quai de Paris (Strasbourg)","link":"","lat":48.5847793,"lon":7.7426822,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:6_Quai_de_Paris_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:6 Quai de Paris (Strasbourg)\"\u003E6 Quai de Paris (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"6 Quai de Paris (Strasbourg)","link":"","lat":48.584773,"lon":7.743002,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:6_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:6 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E6 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"6 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.585074804019,"lon":7.7407801151276,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:6_rue_Kuhn_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:6 rue Kuhn (Strasbourg)\"\u003E6 rue Kuhn (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"6 rue Kuhn (Strasbourg)","link":"","lat":48.5850729,"lon":7.7396371,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:7_Place_de_l%27Homme_de_Fer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:7 Place de l\u0026#039;Homme de Fer (Strasbourg)\"\u003E7 Place de l'Homme de Fer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"7 Place de l'Homme de Fer (Strasbourg)","link":"","lat":48.58415,"lon":7.74396,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:7_Quai_de_Paris_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:7 Quai de Paris (Strasbourg)\"\u003E7 Quai de Paris (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"7 Quai de Paris (Strasbourg)","link":"","lat":48.584961,"lon":7.743164,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:7_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:7 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E7 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"7 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.584846,"lon":7.740379,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:7_place_Cl%C3%A9ment_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:7 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)\"\u003E7 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"7 place Cl\u00e9ment (Strasbourg)","link":"","lat":48.586910149007,"lon":7.7431285595245,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:8_Quai_Kl%C3%A9ber_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:8 Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)\"\u003E8 Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"8 Quai Kl\u00e9ber (Strasbourg)","link":"","lat":48.586084371027,"lon":7.7438244223595,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:8_Quai_de_Paris_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:8 Quai de Paris (Strasbourg)\"\u003E8 Quai de Paris (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"8 Quai de Paris (Strasbourg)","link":"","lat":48.585021,"lon":7.743248,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:8_Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:8 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003E8 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"8 Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.585195456322,"lon":7.7407157421112,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:8_quai_Saint_Jean_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:8 quai Saint Jean (Strasbourg)\"\u003E8 quai Saint Jean (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"8 quai Saint Jean (Strasbourg)","link":"","lat":48.583783096611,"lon":7.7390956878662,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:8_rue_de_S%C3%A9bastopol_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:8 rue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)\"\u003E8 rue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"8 rue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)","link":"","lat":48.5863009,"lon":7.7432256,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:8a_quai_Saint_Jean_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:8a quai Saint Jean (Strasbourg)\"\u003E8a quai Saint Jean (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"8a quai Saint Jean (Strasbourg)","link":"","lat":48.583750115685,"lon":7.7392741325409,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:9_Rue_du_Marais_Vert_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:9 Rue du Marais Vert (Strasbourg)\"\u003E9 Rue du Marais Vert (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"9 Rue du Marais Vert (Strasbourg)","link":"","lat":48.58569,"lon":7.74083,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:9_Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:9 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003E9 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"9 Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.583744948157,"lon":7.7407009899616,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:9_quai_Saint_Jean_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:9 quai Saint Jean (Strasbourg)\"\u003E9 quai Saint Jean (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"9 quai Saint Jean (Strasbourg)","link":"","lat":48.583846973028,"lon":7.739245891571,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:All%C3%A9e_des_Justes_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:All\u00e9e des Justes (Strasbourg)\"\u003EAll\u00e9e des Justes (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"All\u00e9e des Justes (Strasbourg)","link":"","lat":48.585255782365,"lon":7.7416813373566,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Ancienne_Synagogue_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Ancienne Synagogue (Strasbourg)\"\u003EAncienne Synagogue (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Ancienne Synagogue (Strasbourg)","link":"","lat":48.585458,"lon":7.741725,"icon":"/assets/pin.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Ancienne_gare_de_Strasbourg_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Ancienne gare de Strasbourg (Strasbourg)\"\u003EAncienne gare de Strasbourg (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Ancienne gare de Strasbourg (Strasbourg)","link":"","lat":48.58599,"lon":7.74255,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Au_Bon_March%C3%A9_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Au Bon March\u00e9 (Strasbourg)\"\u003EAu Bon March\u00e9 (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Au Bon March\u00e9 (Strasbourg)","link":"","lat":48.5838617,"lon":7.7431231,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Au_Bon_March%C3%A9_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Au Bon March\u00e9 (Strasbourg)\"\u003EAu Bon March\u00e9 (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Au Bon March\u00e9 (Strasbourg)","link":"","lat":48.5838567,"lon":7.7432626,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Au_Bon_March%C3%A9_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Au Bon March\u00e9 (Strasbourg)\"\u003EAu Bon March\u00e9 (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Au Bon March\u00e9 (Strasbourg)","link":"","lat":48.583998857789,"lon":7.7433175269837,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Bon_March%C3%A9_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Bon March\u00e9 (Strasbourg)\"\u003EBon March\u00e9 (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Bon March\u00e9 (Strasbourg)","link":"","lat":48.5841789,"lon":7.7433278,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Bon_March%C3%A9_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Bon March\u00e9 (Strasbourg)\"\u003EBon March\u00e9 (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Bon March\u00e9 (Strasbourg)","link":"","lat":48.5841613,"lon":7.743229,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Canal_des_Faux_Remparts_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Canal des Faux Remparts (Strasbourg)\"\u003ECanal des Faux Remparts (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Canal des Faux Remparts (Strasbourg)","link":"","lat":48.584088283208,"lon":7.7403509616852,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Canal_des_Faux_Remparts_(Strasbourg)/de\" title=\"Adresse:Canal des Faux Remparts (Strasbourg)/de\"\u003ECanal des Faux Remparts (Strasbourg)/de\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Canal des Faux Remparts (Strasbourg)/de","link":"","lat":48.584088283208,"lon":7.7403509616852,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Canal_des_Faux_Remparts_(Strasbourg)/en\" title=\"Adresse:Canal des Faux Remparts (Strasbourg)/en\"\u003ECanal des Faux Remparts (Strasbourg)/en\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Canal des Faux Remparts (Strasbourg)/en","link":"","lat":48.584088283208,"lon":7.7403509616852,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Centre_Commercial_des_Halles_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Centre Commercial des Halles (Strasbourg)\"\u003ECentre Commercial des Halles (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Centre Commercial des Halles (Strasbourg)","link":"","lat":48.585905,"lon":7.742613,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Cin%C3%A9ma_Star_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Cin\u00e9ma Star (Strasbourg)\"\u003ECin\u00e9ma Star (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Cin\u00e9ma Star (Strasbourg)","link":"","lat":48.583866980201,"lon":7.7426665202377,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Couvent_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Couvent (Strasbourg)\"\u003ECouvent (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Couvent (Strasbourg)","link":"","lat":48.584485732757,"lon":7.7396321296692,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Ecole_Saint_Jean_(ancienne)_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Ecole Saint Jean (ancienne) (Strasbourg)\"\u003EEcole Saint Jean (ancienne) (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Ecole Saint Jean (ancienne) (Strasbourg)","link":"","lat":48.58486898472,"lon":7.7392673492432,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Eglise_Catholique_Saint_Jean_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Eglise Catholique Saint Jean (Strasbourg)\"\u003EEglise Catholique Saint Jean (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Eglise Catholique Saint Jean (Strasbourg)","link":"","lat":48.584421857148,"lon":7.7402329444885,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Eglise_Saint_Jean_provisoire_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Eglise Saint Jean provisoire (Strasbourg)\"\u003EEglise Saint Jean provisoire (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Eglise Saint Jean provisoire (Strasbourg)","link":"","lat":48.58472,"lon":7.74007,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Ensemble_de_l%27Homme_de_Fer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Ensemble de l\u0026#039;Homme de Fer (Strasbourg)\"\u003EEnsemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Ensemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)","link":"","lat":48.583923269754,"lon":7.7438914775848,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Ensemble_de_l%27Homme_de_Fer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Ensemble de l\u0026#039;Homme de Fer (Strasbourg)\"\u003EEnsemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Ensemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)","link":"","lat":48.58380793745,"lon":7.7442187070847,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Ensemble_de_l%27Homme_de_Fer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Ensemble de l\u0026#039;Homme de Fer (Strasbourg)\"\u003EEnsemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Ensemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)","link":"","lat":48.583758255761,"lon":7.7443850040436,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Ensemble_de_l%27Homme_de_Fer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Ensemble de l\u0026#039;Homme de Fer (Strasbourg)\"\u003EEnsemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Ensemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)","link":"","lat":48.583499,"lon":7.744768,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Ensemble_de_l%27Homme_de_Fer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Ensemble de l\u0026#039;Homme de Fer (Strasbourg)\"\u003EEnsemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Ensemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)","link":"","lat":48.583553,"lon":7.744732,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Ensemble_de_l%27Homme_de_Fer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Ensemble de l\u0026#039;Homme de Fer (Strasbourg)\"\u003EEnsemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Ensemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)","link":"","lat":48.583588,"lon":7.744703,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Ensemble_de_l%27Homme_de_Fer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Ensemble de l\u0026#039;Homme de Fer (Strasbourg)\"\u003EEnsemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Ensemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)","link":"","lat":48.583915,"lon":7.743689,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Ensemble_de_l%27Homme_de_Fer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Ensemble de l\u0026#039;Homme de Fer (Strasbourg)\"\u003EEnsemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Ensemble de l'Homme de Fer (Strasbourg)","link":"","lat":48.583682,"lon":7.744414,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Entrep%C3%B4ts_SADAL_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Entrep\u00f4ts SADAL (Strasbourg)\"\u003EEntrep\u00f4ts SADAL (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Entrep\u00f4ts SADAL (Strasbourg)","link":"","lat":48.586196149614,"lon":7.7409195899963,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Gare_routi%C3%A8re_des_Halles_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Gare routi\u00e8re des Halles (Strasbourg)\"\u003EGare routi\u00e8re des Halles (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Gare routi\u00e8re des Halles (Strasbourg)","link":"","lat":48.586763910047,"lon":7.7414560317993,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Green_Marsh_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Green Marsh (Strasbourg)\"\u003EGreen Marsh (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Green Marsh (Strasbourg)","link":"","lat":48.586641487243,"lon":7.7402463555336,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Green_Marsh_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Green Marsh (Strasbourg)\"\u003EGreen Marsh (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Green Marsh (Strasbourg)","link":"","lat":48.586723102479,"lon":7.7401873469353,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:H%C3%B4tel_de_Neuwiller_(ancien)_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:H\u00f4tel de Neuwiller (ancien) (Strasbourg)\"\u003EH\u00f4tel de Neuwiller (ancien) (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"H\u00f4tel de Neuwiller (ancien) (Strasbourg)","link":"","lat":48.584439,"lon":7.742025,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:H%C3%B4tel_du_rectorat_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:H\u00f4tel du rectorat (Strasbourg)\"\u003EH\u00f4tel du rectorat (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"H\u00f4tel du rectorat (Strasbourg)","link":"","lat":48.58620502092,"lon":7.7440148591995,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:L%27Espace_des_Halles_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:L\u0026#039;Espace des Halles (Strasbourg)\"\u003EL'Espace des Halles (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"L'Espace des Halles (Strasbourg)","link":"","lat":48.586610707271,"lon":7.7398145198822,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:La_femme_qui_marche_vers_le_ciel_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:La femme qui marche vers le ciel (Strasbourg)\"\u003ELa femme qui marche vers le ciel (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"La femme qui marche vers le ciel (Strasbourg)","link":"","lat":48.585536,"lon":7.742223,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Maison%22_A_l%27Ange%22_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Maison\u0026quot; A l\u0026#039;Ange\u0026quot; (Strasbourg)\"\u003EMaison\" A l'Ange\" (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Maison\" A l'Ange\" (Strasbourg)","link":"","lat":48.585294816825,"lon":7.7402007579803,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:M%C3%A9diath%C3%A8que_Olympe_de_Gouges_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:M\u00e9diath\u00e8que Olympe de Gouges (Strasbourg)\"\u003EM\u00e9diath\u00e8que Olympe de Gouges (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"M\u00e9diath\u00e8que Olympe de Gouges (Strasbourg)","link":"","lat":48.584819304074,"lon":7.738881111145,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:M%C3%A9diath%C3%A8que_Olympe_de_Gouges_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:M\u00e9diath\u00e8que Olympe de Gouges (Strasbourg)\"\u003EM\u00e9diath\u00e8que Olympe de Gouges (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"M\u00e9diath\u00e8que Olympe de Gouges (Strasbourg)","link":"","lat":48.584981,"lon":7.739165,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Petite_rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Petite rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003EPetite rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Petite rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.5839651,"lon":7.7413682,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Place_Cl%C3%A9ment_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Place Cl\u00e9ment (Strasbourg)\"\u003EPlace Cl\u00e9ment (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Place Cl\u00e9ment (Strasbourg)","link":"","lat":48.587065530183,"lon":7.7427595853806,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Place_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Place du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003EPlace du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Place du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.583685,"lon":7.741775,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Pont_de_Paris_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Pont de Paris (Strasbourg)\"\u003EPont de Paris (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Pont de Paris (Strasbourg)","link":"","lat":48.5855743,"lon":7.7435309,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Pont_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Pont de Saverne (Strasbourg)\"\u003EPont de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Pont de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.5843898,"lon":7.7409012,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Pont_du_March%C3%A9_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Pont du March\u00e9 (Strasbourg)\"\u003EPont du March\u00e9 (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Pont du March\u00e9 (Strasbourg)","link":"","lat":48.585227393648,"lon":7.7427810430527,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Quai_Desaix_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Quai Desaix (Strasbourg)\"\u003EQuai Desaix (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Quai Desaix (Strasbourg)","link":"","lat":48.583719220114,"lon":7.7400076389313,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Quai_Saint_Jean_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Quai Saint Jean (Strasbourg)\"\u003EQuai Saint Jean (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Quai Saint Jean (Strasbourg)","link":"","lat":48.584116672565,"lon":7.7398896217346,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Quai_de_Paris_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Quai de Paris (Strasbourg)\"\u003EQuai de Paris (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Quai de Paris (Strasbourg)","link":"","lat":48.584755428886,"lon":7.7421963214874,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Rectorat_de_l%27Acad%C3%A9mie_de_Strasbourg_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Rectorat de l\u0026#039;Acad\u00e9mie de Strasbourg (Strasbourg)\"\u003ERectorat de l'Acad\u00e9mie de Strasbourg (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Rectorat de l'Acad\u00e9mie de Strasbourg (Strasbourg)","link":"","lat":48.5865803,"lon":7.7435389,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Rue_Kuhn_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Rue Kuhn (Strasbourg)\"\u003ERue Kuhn (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Rue Kuhn (Strasbourg)","link":"","lat":48.584925762541,"lon":7.7400290966034,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Rue_de_P%C3%A2ques_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Rue de P\u00e2ques (Strasbourg)\"\u003ERue de P\u00e2ques (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Rue de P\u00e2ques (Strasbourg)","link":"","lat":48.585827101912,"lon":7.7405333518982,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Rue_de_S%C3%A9bastopol_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Rue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)\"\u003ERue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Rue de S\u00e9bastopol (Strasbourg)","link":"","lat":48.5858484,"lon":7.7435362,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Rue_du_Faubourg_de_Saverne_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\"\u003ERue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Rue du Faubourg de Saverne (Strasbourg)","link":"","lat":48.5857442,"lon":7.7399559,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Rue_du_Marais_Vert_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Rue du Marais Vert (Strasbourg)\"\u003ERue du Marais Vert (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Rue du Marais Vert (Strasbourg)","link":"","lat":48.586493,"lon":7.740455,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Rue_du_March%C3%A9_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Rue du March\u00e9 (Strasbourg)\"\u003ERue du March\u00e9 (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Rue du March\u00e9 (Strasbourg)","link":"","lat":48.584706620798,"lon":7.7431646232787,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Rue_du_Noyer_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Rue du Noyer (Strasbourg)\"\u003ERue du Noyer (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Rue du Noyer (Strasbourg)","link":"","lat":48.58464897006,"lon":7.7441865205765,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Rue_du_Vieux_March%C3%A9_aux_Vins_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\"\u003ERue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Rue du Vieux March\u00e9 aux Vins (Strasbourg)","link":"","lat":48.583953433544,"lon":7.7418315410614,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:R%C3%A9sidence_ABRAPA_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:R\u00e9sidence ABRAPA (Strasbourg)\"\u003ER\u00e9sidence ABRAPA (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"R\u00e9sidence ABRAPA (Strasbourg)","link":"","lat":48.587083272488,"lon":7.7411985397339,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:R%C3%A9sidence_Horizon_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:R\u00e9sidence Horizon (Strasbourg)\"\u003ER\u00e9sidence Horizon (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"R\u00e9sidence Horizon (Strasbourg)","link":"","lat":48.586365179367,"lon":7.7420004901957,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Square_Saint_Jean_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Square Saint Jean (Strasbourg)\"\u003ESquare Saint Jean (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Square Saint Jean (Strasbourg)","link":"","lat":48.584556705562,"lon":7.7395462989807,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Station_de_Tram_Ancienne_Synagogue_-_les_Halles_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Station de Tram Ancienne Synagogue - les Halles (Strasbourg)\"\u003EStation de Tram Ancienne Synagogue - les Halles (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Station de Tram Ancienne Synagogue - les Halles (Strasbourg)","link":"","lat":48.585304,"lon":7.742287,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Tour_Esca_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Tour Esca (Strasbourg)\"\u003ETour Esca (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Tour Esca (Strasbourg)","link":"","lat":48.585827,"lon":7.741666,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Tour_Europe_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Tour Europe (Strasbourg)\"\u003ETour Europe (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Tour Europe (Strasbourg)","link":"","lat":48.586763910047,"lon":7.7414560317993,"icon":"/assets/oval-15.png"},{"text":"\u003Cb\u003E\u003Ca href=\"/Adresse:Usine_%C3%A0_Gaz_-_rue_des_Bonnes_Gens_(Strasbourg)\" title=\"Adresse:Usine \u00e0 Gaz - rue des Bonnes Gens (Strasbourg)\"\u003EUsine \u00e0 Gaz - rue des Bonnes Gens (Strasbourg)\u003C/a\u003E\u003C/b\u003E","title":"Usine \u00e0 Gaz - rue des Bonnes Gens (Strasbourg)","link":"","lat":48.5870383,"lon":7.7427776,"icon":"/assets/oval-15.png"}],"imageLayers":[]}


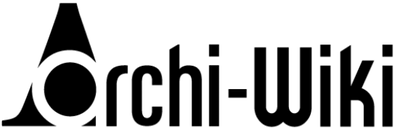




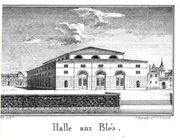







![Source : http://www.witzgilles.com/strasbourg_23_novembre_1944.htm [archive]](/images/thumb/f/f4/2_Quai_Kl%C3%A9ber_Strasbourg_4061.jpg/180px-2_Quai_Kl%C3%A9ber_Strasbourg_4061.jpg)
![Voir la source [archive]](/images/thumb/e/e1/2_Quai_Kl%C3%A9ber_Strasbourg_11109.jpg/180px-2_Quai_Kl%C3%A9ber_Strasbourg_11109.jpg)





















